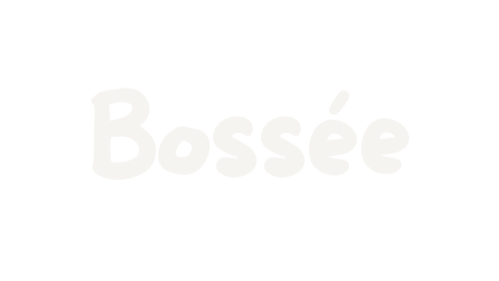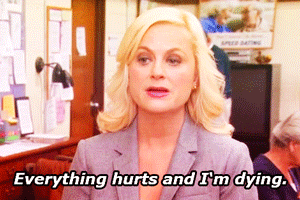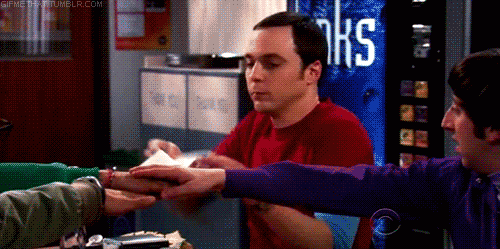Pas le temps d’être malade : la santé des femmes au taf
Octobre. Le mois où tout devient rose, même les packs de yaourts. Mais derrière les campagnes de com bien ficelées, il y a un truc dont on parle peu : la vraie vie des femmes malades au boulot.
Celles qui vont bosser avec une poche de glace sur le bide, qui décalent leur mammographie pour une réunion inutile, ou qui sourient en visio pendant une crise de panique. Pas parce qu’elles sont héroïques. Mais parce qu’elles n’ont pas le choix.
Cet article, c’est pour elles. Pour celles qui se sont déjà dit : “je peux pas m’arrêter, j’ai trop de taf.” Et qui l’ont payé cher.
1. Le "presenteeism" : ce truc qu’on fait toutes
Le “presenteeism”, c’est le fait de bosser alors qu’on est malade. Oui, comme quand t’as une cystite, un SPM de l’enfer, ou une déprime carabinée et que tu continues à envoyer des mails. En mode robot. En mode “tout va bien”.
Une étude suisse publiée en 2023 dans Nature montre que ce phénomène coûte plus cher aux entreprises que l’absentéisme. Pourquoi ? Parce qu’on reste là, inefficace, en souffrance, mais présent.e — alors que ce qu’il faudrait, c’est du repos.
Les femmes sont les premières concernées. Une étude française (Niedhammer et al., 2024) prouve que les contraintes psychosociales du travail (charge mentale, faible autonomie, pression hiérarchique) augmentent les risques de presenteeism — et que ces effets sont plus marqués chez les femmes. On cumule : pression de performance, charge domestique, culpabilité intégrée.
Chez les hommes, le presenteeism existe aussi. Mais les ressorts ne sont pas les mêmes. Eux sont souvent pris dans l’injonction de “tenir bon”, de ne pas craquer, de rester maîtres de la situation. Ils parlent moins, expriment moins. Là où les femmes “planquent” leurs douleurs, les hommes les “nient”. Résultat : même pression, même isolement, mais vécu différemment. Et même issue, souvent : le corps lâche.
2. Les douleurs qu’on tait et qu’on connaît par cœur
Endométriose, règles, syndrome prémenstruel : selon une revue de 2023 (Women’s Health and Working Life), 40 à 70 % des femmes en âge de travailler vivent des douleurs menstruelles. L’endométriose touche 1 femme sur 10. Et pourtant, c’est encore rarement pris en compte dans le monde pro.
Une étude (Soliman et al., 2017) a mesuré les pertes d’efficacité liées à l’endométriose : les femmes ne s’arrêtent pas, elles viennent bosser. Moins bien. Plus lentement. En souffrant. Mais bosser quand même.
Ménopause et périménopause : troubles du sommeil, sautes d’humeur, épuisement. Un moment clé de la vie des femmes, encore vécu dans le silence. Le corps change, le mental aussi. Mais pas un mot. Comme si ça ne devait “pas exister” dans un open space.
Santé mentale : anxiété, dépression, burnout. Invisibles jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Beaucoup trop de femmes tiennent “par habitude”, par peur de craquer, par réflexe de survie. Jusqu’au moment où le corps lâche.
3. Pourquoi on continue ?
Parce que le système est mal fichu. Parce qu’on a peur de déranger. De ne plus être dans la boucle. Parce qu’on veut montrer qu’on est “solide”. Et surtout : parce qu’on n’a pas le temps de se soigner.
Une étude DARES (2024) montre que les horaires rigides et la pression du travail empêchent l’accès aux soins. Le Haut Conseil à l’Égalité (2017) souligne que les femmes, surtout les plus précaires, doivent jongler entre job, famille et rendez-vous médicaux : “La santé passe après tout le reste.”
Tu veux prendre un rendez-vous ? Il faut poser un RTT. Trouver une crèche. Gérer un boss suspicieux. Et espérer qu’il y ait un créneau avant 3 mois.
Ce n’est pas un manque de volonté. C’est un manque de marge. Et cette marge, on l’a pas toutes. Encore moins quand on est femme, qu’on cumule les contraintes, qu’on veut “assurer”.
4. Ce que ça nous coûte, vraiment
Un corps qui s’épuise. Une santé mentale qui vacille. Une estime qui s’effrite. Un suivi médical qu’on reporte. Jusqu’au moment où ça casse.
Et chez les hommes ? Ce n’est pas mieux. Mais c’est différent. Ils parlent moins. Ne consultent pas. N’osent pas dire. Leurs douleurs sont tues, niées. Jusqu’au burn-out, infarctus, ou arrêt brutal.
Là où les femmes s’effondrent doucement, souvent en silence, les hommes s’effondrent d’un bloc. Parce que la société leur a dit qu’ils devaient “tenir bon” jusqu’au bout. Et qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. Deux parcours parallèles, mêmes conséquences.
Personne n’y gagne. Ni eux. Ni nous. Ni le taf.
5. Et maintenant ? On continue comme ça ou on change le scénario ?
Changer, c’est pas révolutionnaire. C’est vital.
Créer des vrais espaces pour parler santé au taf.
Former les RH et managers à la réalité des corps (féminins, mais pas que).
Faciliter l’accès aux soins : horaires flexibles, jours “santé”, tolérance zéro sur les regards biaisés.
Ne plus glorifier celles qui bossent avec 39 de fièvre. C’est pas de la force, c’est du sacrifice.
On mérite pas des médailles pour avoir tenu. On mérite de pouvoir s’écouter. Sans avoir à se justifier.
Conclusion
Ce mois-ci, tout le monde parle de seins. Mais parlons aussi de ventre qui contracte, de dos qui lâche, de têtes qui saturent. De corps qui bossent, alors qu’ils devraient se reposer.
Ce n’est pas une histoire de fragilité. C’est une histoire de système. De culture du déni. Et de femmes qu’on pousse à ignorer ce que leur corps hurle.
Et d’hommes qu’on empêche de dire qu’ils vont mal.
Alors stop. On n’est pas faibles. On est lucides. Et on a le droit de dire : “Là, j’ai mal. Et j’ai besoin de temps.”
Et si, pour une fois, on s’écoutait vraiment ?